
Photos © Daniel Bernard
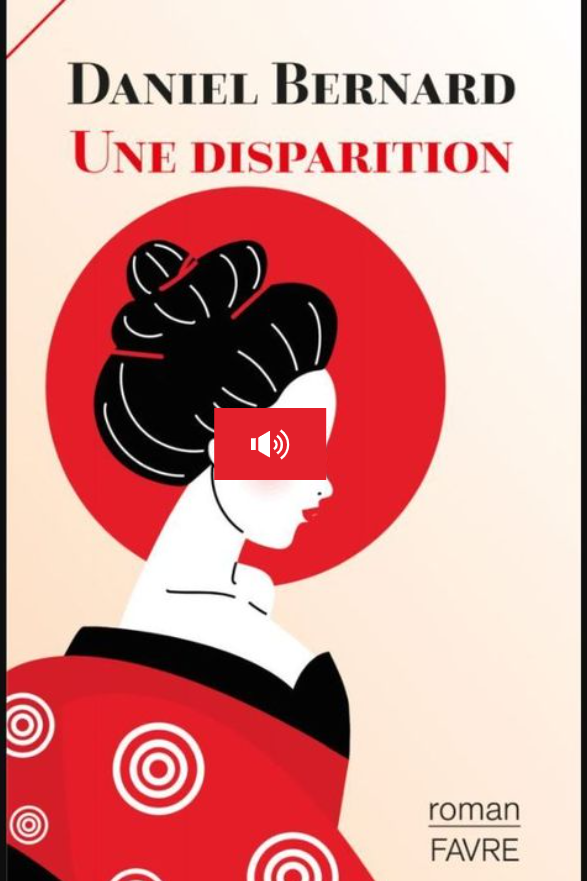
Daniel Bernard a reçu le Prix du Polar Romand 2023 pour son livre intitulé « Une disparition ». Son ouvrage a été sélectionné parmi les trois finalistes. L’histoire se déroule autour d’Akira, un détective japonais qui mène une enquête pour retrouver Natsumi, une opératrice de trains à grande vitesse qui a mystérieusement disparu. Le jury a été impressionné par l’ingéniosité de cette enquête, qu’ils ont qualifiée de « remarquablement écrite avec finesse, subtilité et aisance, par un connaisseur et passionné du Japon, un pays qu’il visite fréquemment ». Originaire de Paris, Daniel Bernard réside en Suisse romande depuis 50 ans. Depuis 2009, il occupe le poste de rédacteur en chef chez France Loisirs en Suisse. Il a une carrière variée en tant que journaliste littéraire, réalisateur de documentaires et de courts métrages. Son livre primé, « Une disparition », est son 23e ouvrage, publié par les éditions Favre.
Monde Economique: Daniel, félicitations pour votre victoire au Prix du polar romand 2023. Comment avez-vous réagi en apprenant que vous aviez remporté le prix ?
Daniel Bernard :Quand on reçoit un Prix, on est assailli par une émotion juvénile. C’est comme si vous retourniez à l’adolescence et que vous obteniez le premier prix après votre année scolaire. Il faut accepter cela avec simplicité, et répondre ainsi à tous les messages sur les réseaux sociaux, les mails, les sms, etc. J’ai donc réagi assez simplement : en étant très content.
Monde Economique: Votre ouvrage « Une disparition » a été salué pour son originalité et sa subtilité. Le personnage principal, Akira, est un policier japonais. Comment avez-vous travaillé sur la création de ce personnage ? Y a-t-il un modèle réel derrière lui ?
Daniel Bernard: Le personnage du flic qui dérape, qui paraît un peu traditionnel au début, est celui qui attire l’attention, bien sûr, alors que l’héroïne disparue semble avoir le premier rôle. C’est assez classique comme façon de procéder : un flic un peu marginal, qui flaire quelque chose dans cette disparition puis qui s’acharne, ne lâche pas le morceau et finit par déraper. Il adopte un comportement marginal, je ne peux pas vous en dire plus. Le modèle ? Peut-être un personnage du romancier américain James Lee Burke, Dave Robicheau. Il n’a l’air de rien, mais il parvient toujours à ses fins, en privilégiant les « gentils » plutôt que de s’en tenir strictement à la loi.
Dans le cas de mon flic Akira, il va sortir des rails en protégeant la fugitive, lui permettant d’échapper à une possible arrestation fortuite où il s’interpose entre la police et elle, alors qu’il est « de la maison ». On aime toujours le côté différent des personnages qui sont toujours dans la normalité le reste du temps. Trop lisse, un héros finit pas vous ennuyer, comme dans la vie.
Monde Economique: Le livre met en lumière un phénomène de société au Japon, celui des « johatsu » ou « les évaporés ». Pourquoi avoir choisi de traiter ce sujet ? Qu’est-ce qui vous a particulièrement marqué à ce propos ?
Daniel Bernard: Le phénomène des disparitions volontaires n’est pas que japonais. Vous pouvez déclarer à la police que vous allez changer d’adresse, mais que vous ne voulez plus être en contact avec les vôtres, du moment que vous vous acquittez de vos charges sociales et de vos impôts. Au Japon, c’est le nombre de ces « évaporés » qui est frappant, environ 10’000 personnes par an. Du jour au lendemain, vous disparaissez. Bien sûr, les milieux louches sont de la parties, les yakuzas, la mafia locale, très puissante et coûteuse, arrange les choses. Dans la nuit, votre appartement est vidé, et les voisins n’y ont rien vu. C’est un sujet tabou, et au Japon, le silence est roi.
Quand je commençais à rédiger le texte, une française a été portée disparue, en 2018. Jamais retrouvée, la famille s’est rendue sur place, des inspecteurs français, le consul, et j’en passe. Tout le monde s’est trouvé confronté à la barrière de la culture, de l’honneur, des façons de faire. La douleur a fait écrire, selon moi, des inepties, alors qu’il s’agit d’une différence de mentalité ou l’honneur et la honte possible sont au premier rang.
Dans mon livre, on se glisse dans la mentalité locale, et cela peut paraître surprenant de découvrir la lenteur de la police, les silences, l’abandon, ou la trahison, tout cela de façon apparemment froide et flegmatique alors que cela est bouillant en dedans. C’est pour cela que le côté choral du roman est dans le fait que je donne la parole aux trois protagonistes : ils se livrent à nous, à la première personne. Cela change le registre de langage et le ton, puis on revient à la troisième personne, comme dans tout roman. J’ai voulu sonder l’âme des personnages, pour autant que faire se peut. Ce sont comme des confessions faites au lecteur, ou des journaux intimes. Dans la vraie vie, on ne raconte pas ces choses aux gens qui vous entourent ! Ici, on les lit.
Monde Economique: Votre lien avec le Japon est clairement affirmé dans ce livre. Pouvez-vous nous en dire plus sur votre relation avec ce pays et comment cela a influencé votre écriture ?
Daniel Bernard: Mon fils cadet vit là-bas depuis 15 ans, il s’y est marié, et il a un fils, Takumi, auquel j’ai dédié mon livre. J’y vais près d’une fois par année. J’avais découvert le Japon avant, bien sûr, avec la culture cinématographique, durant mes études de cinéma à Paris, avec les formules 1 des années 60, la première voiture de course 100% japonaise, puis avec le matériel vidéo Sony professionnel quand je travaillais à la télévision locale genevoise ou dans ma propre structure de production. Le fait que mon fils vive au Japon, bien sûr, cela a accusé le trait. Quand j’y vais, je vis la vie quotidienne de la famille, je me déplace en train, seul ou avec les miens, j’ai sillonné le pays grâce au Railway pass qui donne accès au Shinkansen autant que vous le voulez, j’ai dormi dans des petits hôtels et non pas des 4 ou 5 étoiles pour les touristes, je mange dans la rue en achetant dans les kombini (les 7/7 ouvert 24/24h et 7/7jours) plutôt que dans les restaurants… pour touristes ! Comme ici quand vous prenez votre sandwich à la Migros ou à la Coop.
Par ailleurs, ce qui a influencé mon écriture, c’est non seulement un cinéaste comme Kurozawa (L’ombre du guerrier : Kagemusha), mais aussi quelques auteurs classiques comme Mishima, Yoshimura ou Kenzaburo). Ils ont une façon singulière de décrire une émotion, avec des détails qui peuvent échapper à première vue, avec un lien constant entre la réalité des choses et l’intériorité de chacun. Je n’oublie pas non plus que mes personnages sont des contemporains, qu’ils ont connu la guerre, pour les plus âgés, et Pearl Harbor, Hiroshima, le tsunami de Fukushima pour les plus jeunes. Ils célèbrent leurs fêtes religieuses toujours, en prenant un train à grande vitesse ou un tortillard, en costume cravate ou en kimono. Mon héroïne Natsumi change de personnage en étant plus kawaï (mode japonaise un peu déjantée) alors qu’elle portait la tenue de la Japan Railways quelques jours plus tôt !
Monde Economique: Vous êtes un journaliste littéraire, réalisateur et rédacteur en chef reconnu. Comment ces expériences ont-elles influencé votre approche de l’écriture de romans ?
Daniel Bernard: En fait, j’ai toujours écrit et toujours filmé avant même de faire des photos. A l’âge de 13 ans, mon père m’a donné sa caméra Paillard Bolex 8mm achetée à Genève avant note départ pour l’Inde. J’étais tout jeune. J’ai par la suite découvert à l’internat le plaisir de l’écriture. J’écrivais des poèmes, en 1967 et 1968, influencé par Saint-John Perse, dans les textes duquel il y avait le soleil des îles de la Martinique. Puis j’ai découvert Camus et ce même soleil. Alors j’ai écrit mon premier roman. J’avais 16 ans ! Puis avec les études de cinéma, j’ai découvert l’écriture des scénarios et des dialogues.
J’ai eu un professeur illustre à l’époque, Jean Ricardou. C’était le nouveau roman, la nouvelle vague : on a retenu Michel Butor, à Genève particulièrement car il y a enseigné. Je l’ai rencontré et interviewé vers la fin de sa vie. Puis j’ai écrit de nombreuses pièces de théâtre, puis des romans pour la jeunesse. Avant cela, ma première publication est un roman, Ciel bleu-rose, que j’avais expédié chez Gallimard ! Nous étions en 1991. Ils m’avaient répondu que c’était une première tentative prometteuse, qu’on sentait l’influence de mon métier de cinéaste, à cause du montage des textes entre eux. C’est finalement une éditrice genevoise qui a accueilli mon texte, Les éditions de l’Emeraude, et le libre fut imprimé chez Slatkine.
Entretemps, j’ai poursuivi ma carrière audiovisuelle : il fallait nourrir la famille et moi-même. Le journalisme littéraire que j’ai développé, c’est par mes interviews filmés à Léman bleu puis avec les rencontres à la FNAC et maintenant avec mes bulles vidéo sur les réseaux informatiques pour France Loisirs, depuis 2008 : nous étions des précurseurs. Aujourd’hui, tout le monde fait cela. J’ai obtenu la confiance de France Loisirs en Suisse. Je me suis donc occupé des auteurs depuis 15 ans, tout en écrivant toujours. Je passe d’un style d’écriture à l’autre sans trop difficulté. Je change de ton, mais mes phrases restent les mêmes.
Monde Economique: « Une disparition » est votre 23e livre. Comment voyez-vous l’évolution de votre écriture depuis votre premier livre et quelle perspective pour le polar ?
Daniel Bernard: Pour moi, l’écriture est un plaisir, toujours porté par les circonstances de la vie. L’internat quand j’étais adolescent où j’ai découvert l’art poétique, un premier divorce qui m’a fait écrire Juliette au passé simple, un dialogue pour la scène, le fait que je quitte la télévision Léman bleu en 2003 : cela m’a dirigé vers le théâtre avec ma première pièce Oui, tout ce bruit, un hommage à Albert Camus et la genevoise Isabelle Eberhardt, puis la récente pandémie, durant laquelle j’ai composé quatre romans dont le deuxième paru est Une disparition. Le confinement et le silence de la campagne aident au travail matinal.
Entre deux, juste avant le COVID, j’ai écrit Un dernier charleston, Louise, publié par une maison qui a sombré. Ce texte autour de Louise Brooks, la star du muet, va d’ailleurs reparaître à Paris cet automne chez un éditeur qui avait publié Moi, Alexandre Yersin, journal apocryphe en 2015. Enfin, concernant le polar, j’ai deux polars genevois qui vont paraître chez Romann, à Montreux. Ce sont des textes moins poétiques, plus radicaux, ce sont de vrais polars. Une chose est sûre, le roman policier, dit « de genre » ou « de gare » a acquis ses lettres de noblesse au fil du temps, les influences sont nombreuses : Etats-Unis, France, Suède ou Norvège, Japon … et Suisse. Certains disent qu’il y a profusion d’auteurs, trop de livres. Il n’y a jamais trop de livres.
Par ailleurs, l’édition traditionnelle a peur des nouveaux moyens de lecture, comme la liseuse ou la tablette. Moi, cela ne me fait pas peur. J’ai commencé ma carrière avec la pellicule et aujourd’hui mes images sont numériques. C’est le même processus, celui de lire des mots, qu’ils soient imprimés ou lus sur un écran. Le support a changé, pas l’intention, mais hélas on se fixe sur l’objet livre, qui est magnifique, certes ! Il n’y a pas de combat entre les deux styles d’approche : ou bout, vous avez l’émotion, l’imaginaire des auteurs…. Une chose est sûre malgré tout, le polar est un genre où l’on peut glisser toutes les activités humaines, toutes les émotions, certes aussi la mort, la violence, la trahison, mais aussi l’amour !
Retrouvez l’ensemble de nos Intertviews